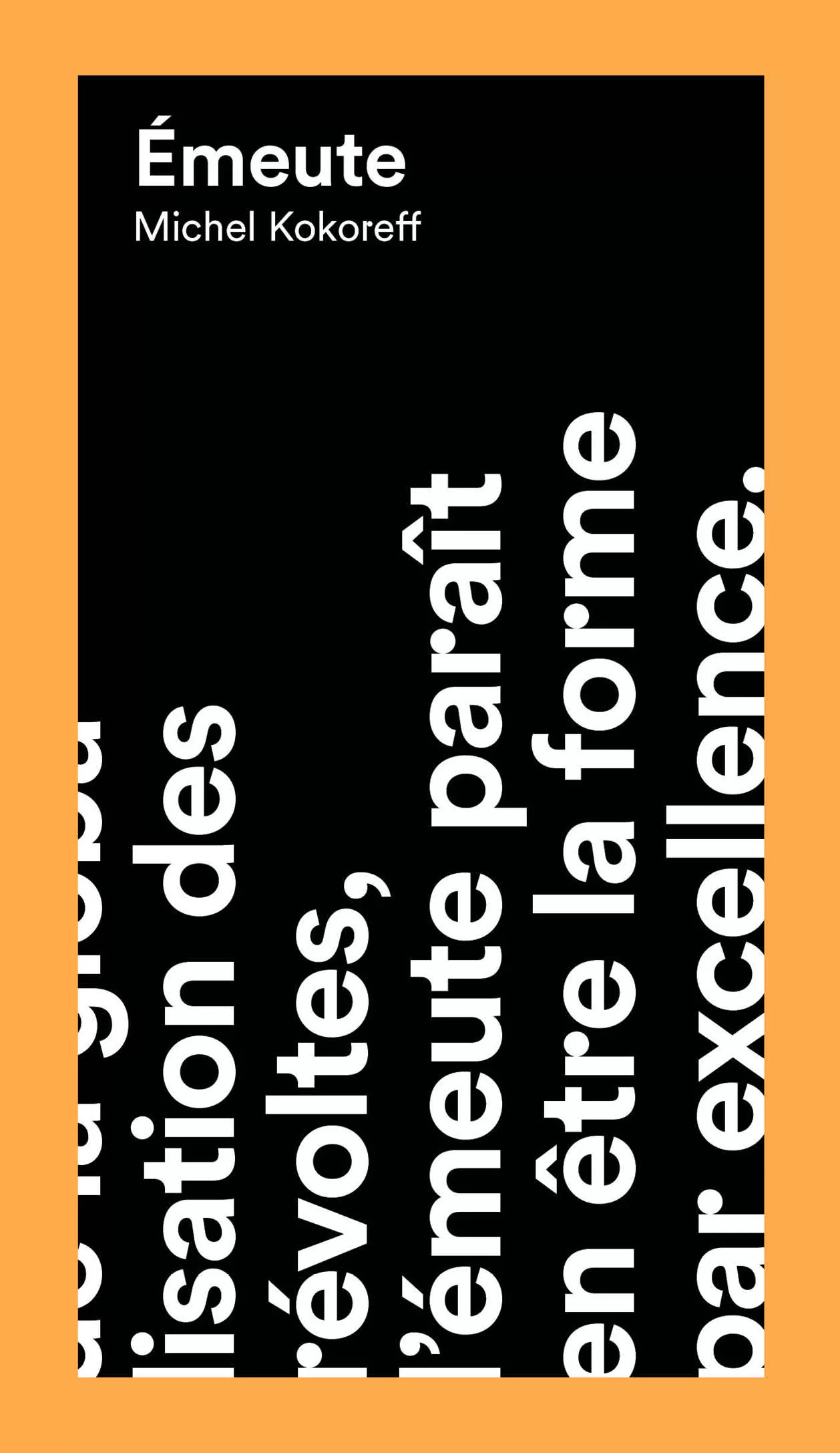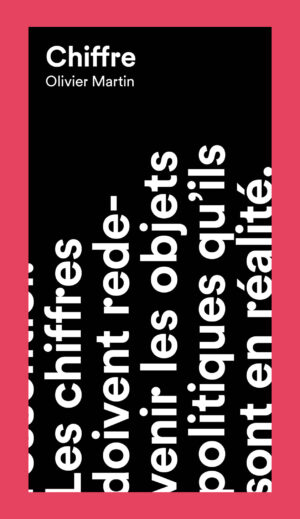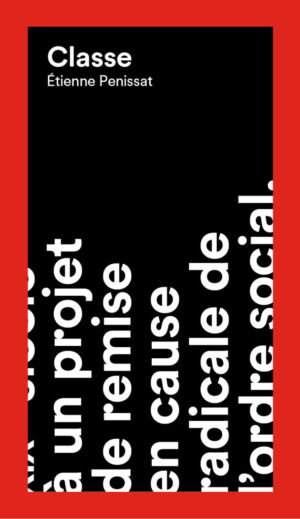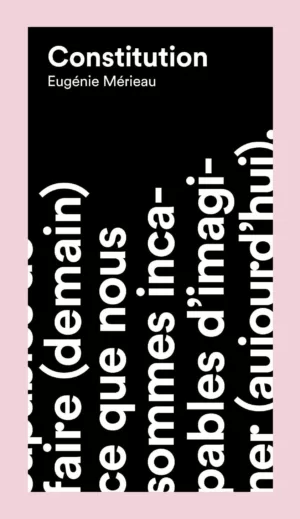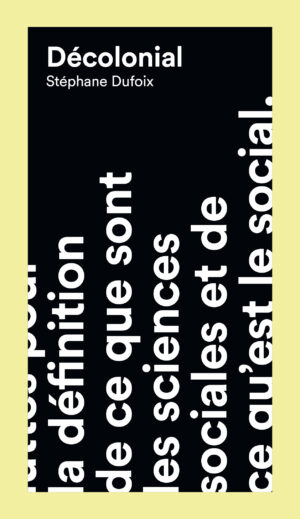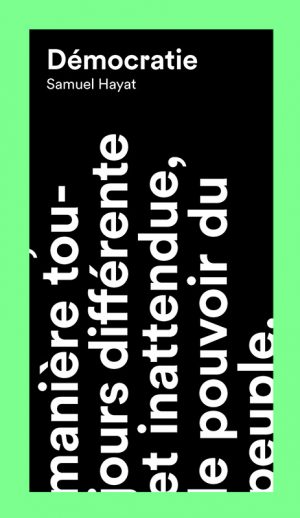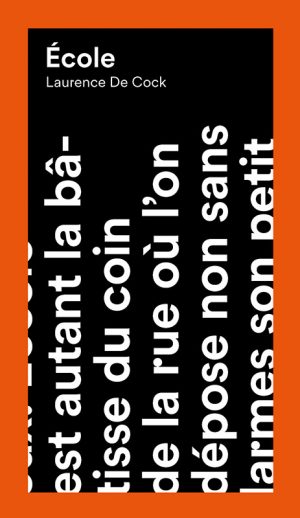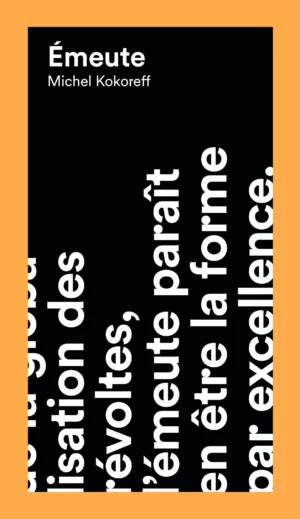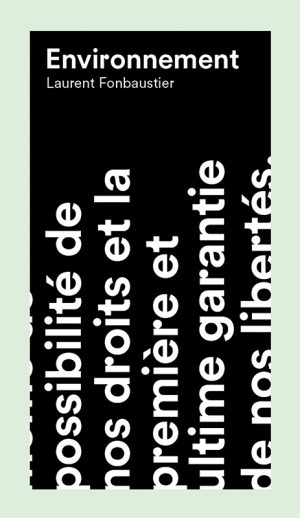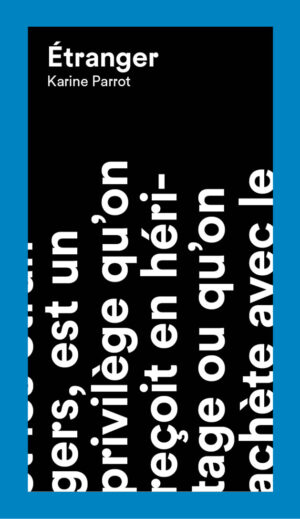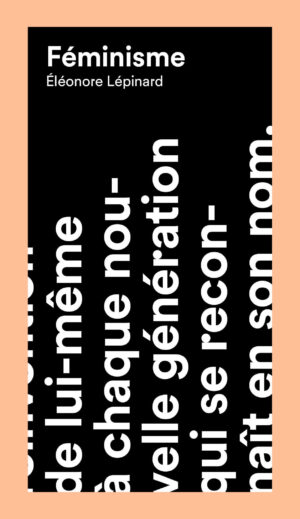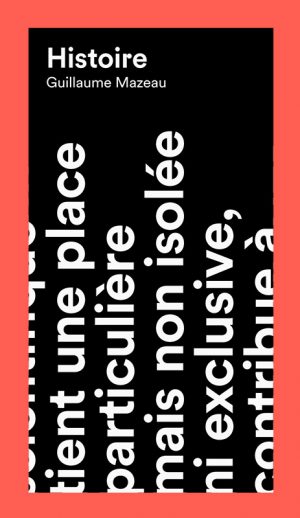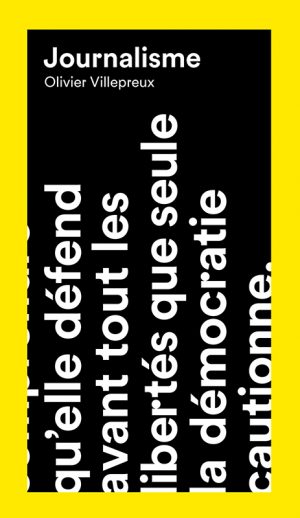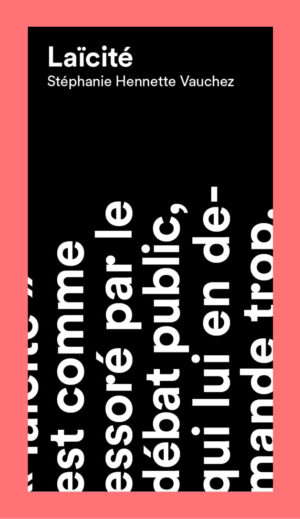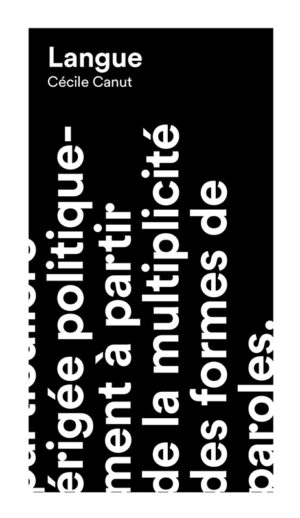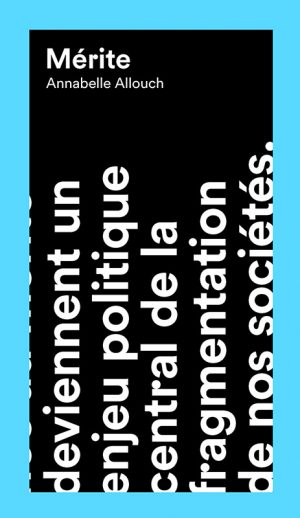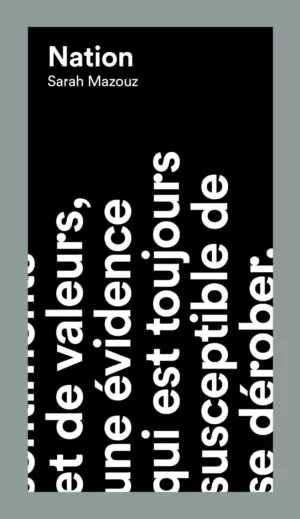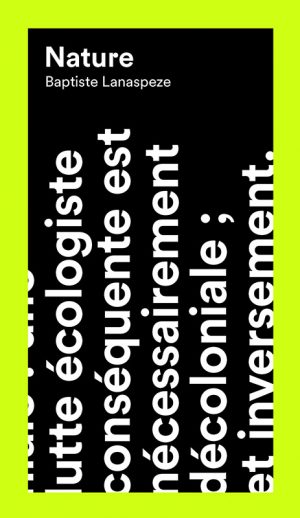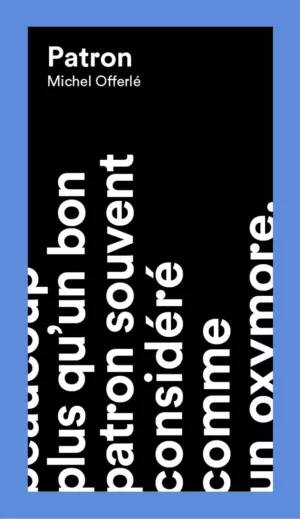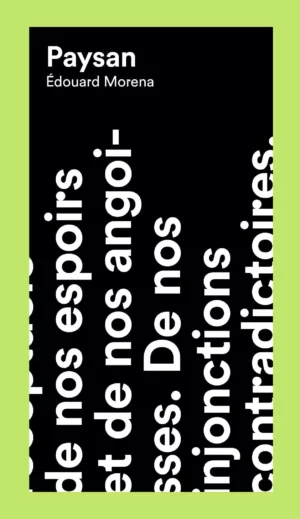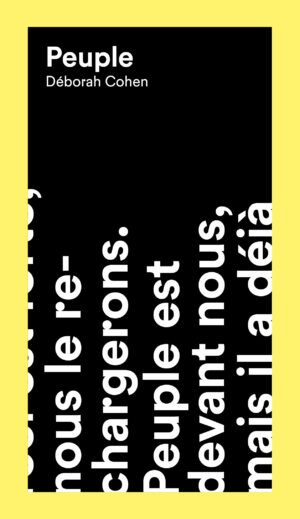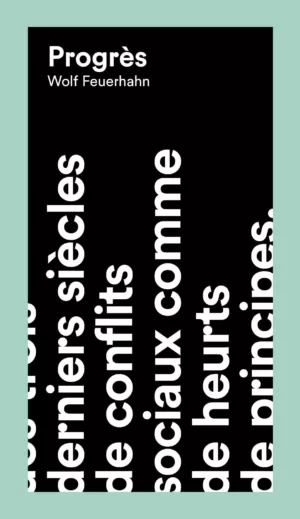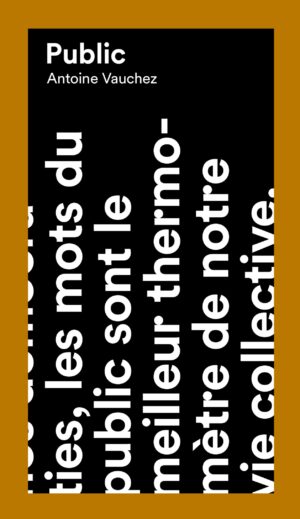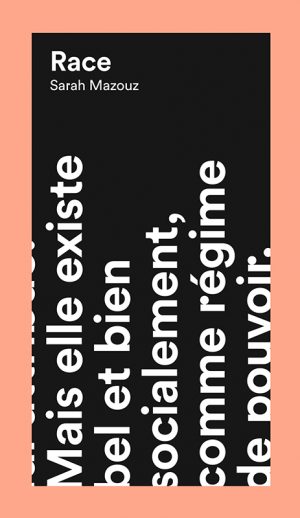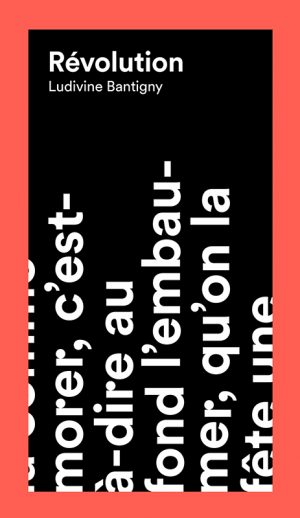Description
Sortie : 16 janvier 2025
112 pages
N° ISBN : 978-2-38191-115-1
Version numérique : 5,99 €
ISBN : 978-2-38191-
Table des matières
La mort de Nahel et les émeutes de la mort
D’une vague d’émeutes l’autre (2005-2023)
Des banlieues invisibles
Identité et participation des émeutiers
Le choix des mots
Des « grandes émotions » aux insurrections ouvrières
Généalogie des émeutes de la mort
L’extension du domaine de la rage
De l’émeute au fascisme
Références
Remerciements
La presse en parle
– Le Monde, Le livre du jour, Marion Dupont, extraits :
« De quoi se compose l’émeute ? De rien et de tout. D’une électricité dégagée peut à peur, d’une flamme subitement jaillie, d’une force qui erre, d’un souffle qui passe. Ce souffle rencontre des têtes qui parlent, des cerveaux qui rêvent, des âmes qui souffrent, des passions qui brûlent, des misères qui hurlent, et les emporte ». Un siècle et demi plus tard, devant les multiplications des embrasements urbains et populaires, la question posée par Victor Hugo dans Les Misérables (1862) méritait d’être posée à nouveaux frais. (…)
Prenant pour point de départ et pour principal objet les émeutes de la mort qui se succèdent dans les quartiers et banlieues populaires en France depuis les années 1970, (…) l’ouvrage explore ce qui, d’un épisode à l’autre, reste. (…) Le sociologue s’est attelé à rendre sa signification politique à un phénomène aussi vite médiatisé qu’oublié, pour tenter d’expliquer la montée et la récurrence de ces violences. (…)
Car si l’émeute en elle-même ne résout rien – « l’émeute étant précisément, ce reste : l’inconciliable » note Michel Kokoreff -, l’absence de réponse politique la condamne à la répétition et à son instrumentalisation par l’extrême droite pour accréditer l’idée qu’un pouvoir autoritaire pourrait, lui mettre un terme au cycle de la violence.
– chronique d’Arnaud Maisetti pour la Fabrique urbaine (à partir de la 22e minute) : https://euradio.fr/emission/KYnz-la-fabrique-urbaine/Y8QA-pour-un-urbanisme-du-care-la-fabrique-urbaine-90
– « Je range mon bureau » Guillaume Cingal sur Youtube à 3’05 : https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0ntrXke1Cuk